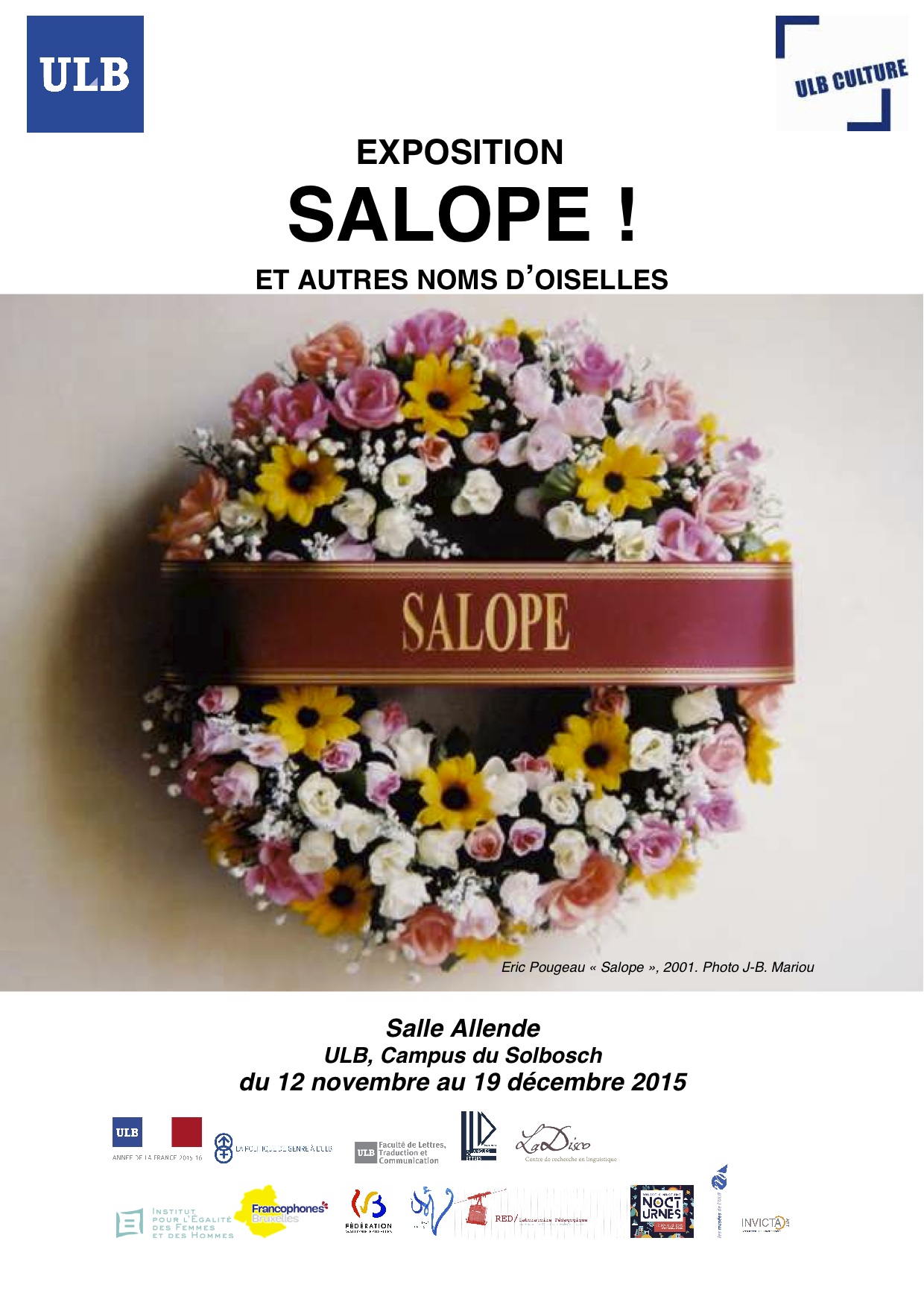Nouria Hernandez, première rectrice de l'Unil
- Écrit par Nathalie Brochard

Nouria Hernandez, biologiste spécialiste du génome, vient d’être élue rectrice avec deux tiers des voix, par le Conseil de l’Université de Lausanne, composé de professeur-e-s, de représentant-e-s du corps intermédiaire et des étudiant-e-s. C’est la première fois dans l’histoire de l’université vaudoise qu’une femme sera à sa tête. Rencontre avec une pionnière.
l’émiliE : Vous êtes la première femme à accéder au poste de rectrice de l’université de Lausanne depuis sa création en 1537, avez-vous conscience d’ouvrir une brèche ?
Nouria Hernandez : Je pense que la brèche a vraiment été ouverte lorsqu’une rectrice a été élue à la tête d’une université en Suisse. Ça c’était historique. Maintenant ça devient plus courant, il y a plusieurs universités en Suisse qui ont ou qui vont avoir à leur tête une rectrice. Mais ça fait plaisir que ce soit aussi le cas à Lausanne.
Et vous-même, en tirez-vous une fierté particulière ?
Je dirais que ça met une pression supplémentaire. Quand on est une femme et qu’on a un poste à responsabilité, on n’a pas droit à l’erreur. Si jamais notre boulot n’est pas parfait, le premier reproche qui nous sera formulé, c’est «ah, mais c’est parce que c’est une femme qu’elle n’a pas su faire le travail» alors que pour un homme on va dire «ah, il n’a pas su faire le travail» et c’est tout sans le relier à son genre. C’est donc une pression qu’il faut pouvoir ignorer autrement on ne fait plus rien.
Vous êtes en quelque sorte condamnée à l’excellence ?
Oui enfin «condamnée»… L’excellence est une valeur à laquelle j’aspire de toute façon, mais il est vrai qu’on a plus peur de ne pas l’atteindre quand on est une femme, parce qu’on vit avec ce paramètre «elle n’y arrive pas parce qu’elle est une femme».
Vous allez prendre vos fonctions dans un an seulement, cela vous laisse le temps de vous préparer. Vous êtes impatiente ?
Je suis très contente que ce ne soit pas immédiat. J’ai beaucoup à faire dans cette année qui vient, notamment dans mon laboratoire de recherche, car dans un an mon activité va considérablement y diminuer. J’aimerais aussi me préparer au mieux pour le métier de rectrice qui m’attend et réfléchir à l’impulsion que je voudrais donner en tant que rectrice. Au départ, on a des tas d’idées mais on est vite rattrapé-e par la réalité, je devrai probablement limiter mes ambitions. Pour l’heure, je sais ce que je veux faire en gros mais je dois travailler sur comment le faire, comment le rendre possible.
Alors justement quel sera votre plus grand défi ?
Dans une université, on ne peut rien faire si on n’a pas la grande majorité des gens avec soi. Le milieu universitaire est constitué de personnalités très fortes, de gens très intelligents et s’ils ne sont pas d’accord avec votre démarche, il est impossible d’avancer. Un des défis sera de convaincre les gens et de les faire adhérer aux projets. D’où l’importance de trouver des projets fédérateurs qui concernent toutes les facultés. Je suis biologiste et j’ai bien sûr un intérêt en biologie et en médecine mais je ne peux pas me limiter à cela en tant que rectrice. Je ne représente pas les intérêts de la faculté de médecine et biologie à ce niveau. Il faut avoir une base unie et commune de façon à avancer.
La durabilité à laquelle vous attachez une grande importance serait un de ces projets fédérateurs ?
J’entends la durabilité dans le sens de la maîtrise de notre avenir. L’Université de Lausanne fait déjà beaucoup, c’est la seule en Suisse à avoir un dicastère qui s’occupe de durabilité. Pour ma part, j’aimerais que les gens prennent conscience que ce n’est pas un problème technologique, un nouveau panneau solaire ne suffira pas à résoudre le changement climatique. C’est un problème de société qui nous concerne tous et toutes. Il faut changer notre modèle de croissance. La croissance à court terme n’est plus un modèle viable. On doit impliquer tous les domaines de recherche pour éviter le pire : sociologues, politologues, évidemment économistes, tout le monde doit réfléchir à un autre modèle qui ne soit pas basé sur la croissance mais qui permette quand même la prospérité. Les religions, les lettres, les historien-ne-s, un tel projet devrait pouvoir intéresser tout le monde. Mais une fois encore, je ne peux pas imposer cette direction. Je peux juste convaincre.
L’égalité s’inscrit-elle dans ce programme ?
L’Université de Lausanne a déjà une vision en la matière. Je pense qu’il faut augmenter le nombre de professeures, cela déclenchera une sorte de cercle vertueux.
Dans quel sens ?
Cela donne un modèle à nos étudiant-e-s : on peut être une femme, professeure d’université et avoir une vie de famille. Beaucoup pensent encore que devenir professeure signifie renoncer à tout le reste. C’est possible même si ce n’est pas simple.
Il y a aussi le plafond de verre qui limite la progression des femmes ou bien?
Dans ce que j’observe, trouver un travail en milieu académique implique d’être mobile. Dans mon cas, j’ai trouvé ce poste aux Etats-Unis où je faisais un stage post-doctoral. Ce n’était pas mon pays, je n’avais aucune raison de rester là-bas. Si j’avais eu une famille à ce moment et que mon mari travaillait en Suisse, la décision aurait été douloureuse, j’aurais eu à choisir.
Certes, mais le problème n’est pas toujours un choix personnel, la disproportion s’explique par le fait que l’institution privilégie les hommes au détriment des femmes…
Oui bien sûr, cela se produit probablement dans certaines facultés où la proportion de femmes professeures est très basse. Il y a encore cette culture-là, mais on peut corriger ce problème, c’est une question de volonté.
Vous pensez corriger cette disproportion au niveau des postes de professeur-e-s ?
J’espère. Déjà, on doit s’en tenir aux mesures pratiques : quand il y a des candidats pour un poste, on doit veiller à ce qu’il y ait des candidates quitte à prolonger le délai de dépôt de candidature. Ensuite au moment de la sélection, on doit combattre cette tendance actuelle qu’il y a de croire qu’un homme est plus compétitif, plus dédié à réussir.
Aujourd’hui, une mobilisation des assistant-e-s de l’Unil dénonce la précarisation de leurs postes et l’absence de dispositifs de recours en cas de conflit avec la/le directrice-eur de thèse. Quelle est votre position ?
C’est un peu difficile pour moi de m’exprimer sur ce sujet. En faculté de biologie et de médecine, il y a un comité et pas une seule personne responsable face à l’étudiant-e. Pour le problème des contrats renouvelables (1+2+2), je suppose qu’on pourrait améliorer le fait que le renouvellement soit une décision prise de manière plus collégiale et pas uniquement par le/la directeur-trice de thèse. Pour autant le/la directeur-trice de thèse a une expérience et est à même d’évaluer la capacité d’un-e étudiant-e à aller jusqu’au bout. Après une année, on peut savoir si la personne est faite pour continuer sa thèse. J’en ai discuté avec les représentant-e-s des thésard-e-s qui veulent un contrat de cinq ans et sur ce point je ne suis pas d’accord. Mais comme je le disais, il y a des améliorations à faire sur tout le processus.
Vous avez déclaré «croire dans le pouvoir de l’individu». Pas dans celui du collectif ?
Ah non, ça ne veut pas dire ça. En Europe, je perçois un certain pessimisme. Je crois qu’en tant qu’individu, on peut changer les choses. De ça, les Américains sont persuadés. On dit toujours qu’ils ont un optimisme naïf, c’est peut-être vrai, mais je retiens surtout le mot optimisme. Par ailleurs, l’individu peut organiser la collectivité. Et chaque individu a quelque chose à apporter.
Photo DR