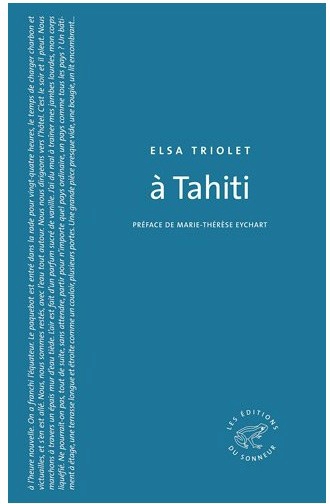
Elsa Triolet, née Ella Kagan en 1896 à Moscou et morte Elsa Triolet en 1970 à Saint-Arnoult en Yvelines, a été la première femme à obtenir le prix Goncourt avec son livre Le premier accroc coûte 200 francs en 1945. Cette grande dame de l’écriture nous a laissé plus de trente ouvrages, sans compter ses traductions d’auteurs russes en français et d’auteurs français en russe et ses multiples contributions dans les revues littéraires, notamment les Lettres françaises.
Dans ce livre, A Tahiti, écrit en Russe puis traduit en français par elle-même, elle a 19 ans, soit neuf ans avant sa rencontre avec Louis Aragon. Elle vient d’épouser un officier français André Triolet, qui l’emmène avec lui pour une mission « au bout du monde ». Elsa s’ennuie. Désabusée par un amour impossible avec le poète Maïakovski, elle partage la vie coloniale d’un mari qu’elle respecte certes, mais qu’elle n’aime pas. Alors elle écrit, et très bien, pour notre bonheur à toutes et tous.
La fraîcheur de style de cette autobiographie est accompagnée d’un « parfum sucré de vanille ». Elsa nous décrit à sa manière l’été, un soir de janvier : « Le cerveau travail de plus en plus au ralenti, le jours devient plus gris et s’éteint. L’air se fait plus compact, vous enserre, vous étouffe. On voudrait enlever avec les mais ce poids humide, gris. Le temps s’arrête. » Pas vraiment, parce qu’elle ne s’arrêtera jamais d’écrire jusqu’à la fin de sa vie.
A Tahiti d’Elsa Triolet, 154 pages, réédité en septembre 2011 par les Editions du Sonneur.
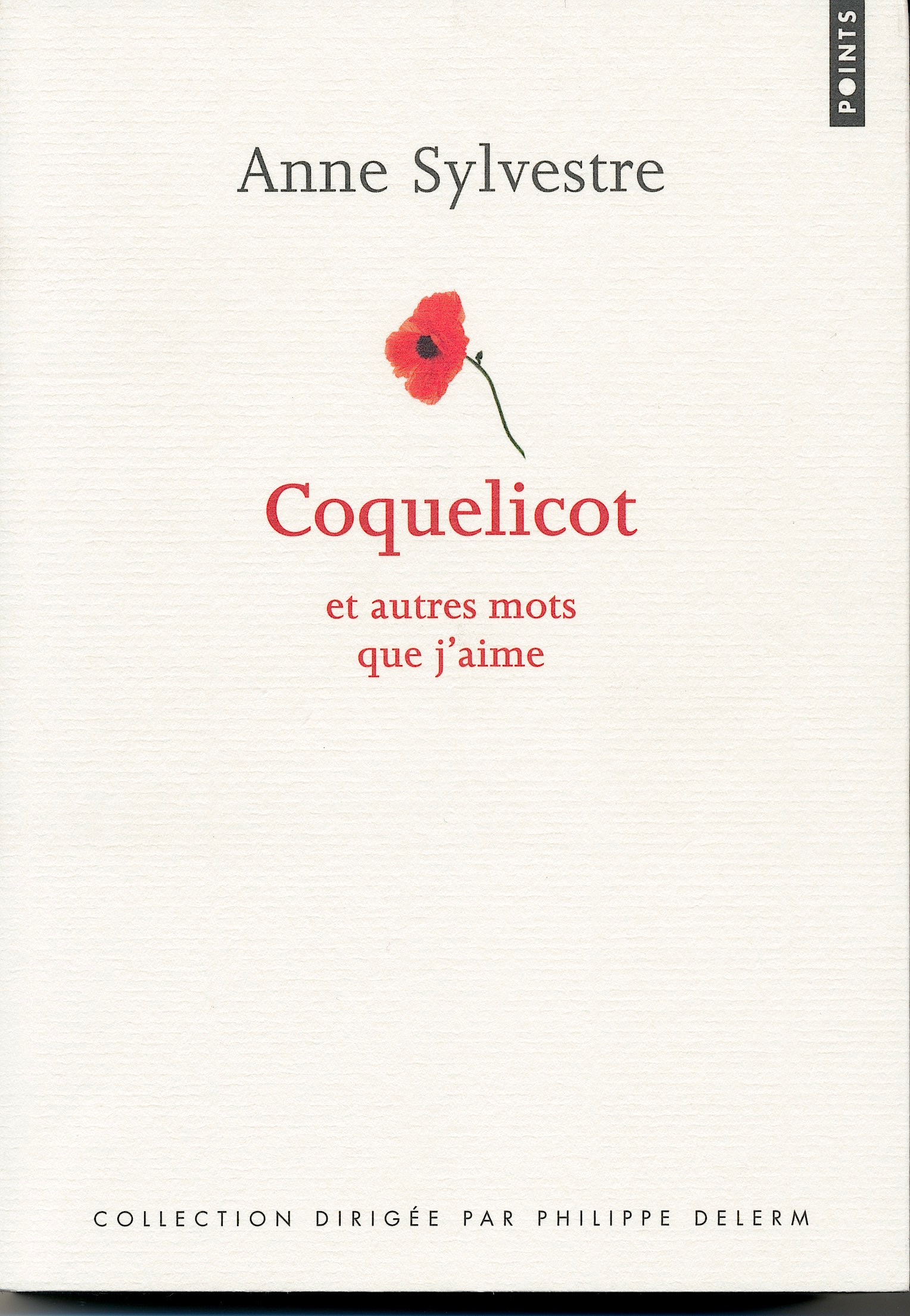
Anne Sylvestre, chanteuse et poète, qui assista notre regrettée Barbara et porta la chanson française à ses sommets, nous a offert ce livre de poésie, où les mots sont tour à tour dépecés pour nous présenter un plat finement cuisiné, au parfum de l’excellence culturelle.
A une époque où les mots font surtout du bruit, elle remet les pendules à l’heure tout en offrant le libre cours d’une imagination qui fait appel à la nôtre. Une sorte d’atelier d’écriture, une invitation à dépasser le premier degré du sens pour rejoindre la respiration de l’enfance. Facile à lire, à prendre à n’importe quel chapitre de ses 81 mots préférés, comme un immense bouquet qui pourrait faire le tour de la terre.
Anne Sylvestre, née à Lyon en 1934, s’est produite la première fois à Bobino, en 1962, en première partie de Jean-Claude Pascal. Depuis, elle a fait un parcours sans faute de qualité, d’expression au service du féminisme et de l’humanisme, sans jamais céder à l’angélisme ou aux sectarismes de circonstance. On a peine à imaginer que Coquelicot… soit son premier livre vu l’importance de son répertoire. C’est pourtant vrai, et on en redemande.
Elle commence par Coquelicot «mot claquant, insolent, cueille-moi si tu l’oses, je me fanerai aussitôt mais regarde...». Il permet à la culture de ne jamais s’enfermer dans le sillon des certitudes. Elle finit par le mot «mot». Son dernier mot ? Mon œil !

Iris Meyer–von Roten est une féministe suisse alémanique trop peu connue, hélas, du public romand. Née à Zurich en 1917 dans une famille protestante, elle a rencontré son futur mari à l’Université de Berne où ils étudiaient le droit. Ils ont ensuite vécu en Valais et à Bâle. Très malade, elle s’est donné la mort en 1990. Elle a travaillé dans plusieurs journaux comme rédactrice responsable et a notamment publié un essai percutant – Frauen im Laufgitter – qui n’a jamais été traduit en français. Ce texte très polémique à l’époque (1958) lui a valu l’opprobre de nombreux critiques et fort peu d’éloges de la part de femmes engagées.
Iris Meyer était une très forte personnalité, une très belle femme, soucieuse de son apparence, qui adorait s’habiller avec goût et originalité. Sa plume est également remarquable, comme d’ailleurs celle de son mari, Peter von Roten.
C’est un plaisir sans précédent de lire les lettres qu’ils ont échangées entre 1943 et 1950. On entre dans leur intimité, aussi bien affective qu’intellectuelle, leurs idées sur la vie, leurs peurs, leurs attentes comblées ou déçues. On découvre ce qu’était le quotidien des étudiants pendant la guerre, les obstacles immenses que rencontraient les jeunes femmes désireuses d’être indépendantes. On mesure le poids des traditions catholiques et familiales sur le destin d’un jeune homme doué et amoureux.
Le style de ces missives est très caractéristique de l’époque : distingué, sans pathos, mais très élaboré, très pur. D’une honnêteté parfaite.
Wilfried Meichtry a fait un travail remarquable de mise en situation de ces lettres, en utilisant de nombreuses archives, et en interviewant des membres des deux familles Cet ouvrage restitue au final le mode de vie et de pensée des jeunes gens avides de changements des années 40 et 50, dans une Suisse encore fort rétrograde.
Un livre de 643 pages jamais ennuyeuses, toutes intéressantes et parfois très touchantes.
Amours ennemies : Iris et Peter von Roten, de Wilfried Meichtry
Traduit de l’allemand par Delphine Hagenbuch et Johan Rachel
Ed. monographic, 2014
643 pages
Photo DR
]]>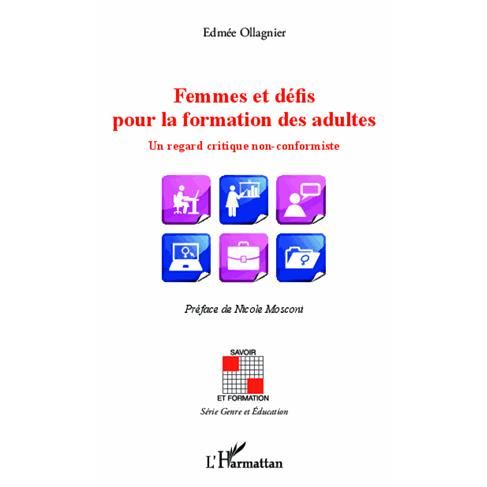
Femmes et défis pour la formation des adultes. Un regard critique non-conformiste d’Edmée Ollagnier va sans doute devenir la référence dans le monde de l’éducation des adultes. Ouvrage complet, il rassemble théories, pratiques, exemples, dispositifs, il ouvre en outre des perspectives en proposant des pistes novatrices. La longue expérience de l’auteure tant en Europe que dans le reste du monde, tant en milieu universitaire que sur le terrain donne à son travail une dimension particulièrement variée et riche. Vous allez me dire «encore un bouquin académique auquel on ne comprend rien» eh bien pas du tout et comme le dit Nicole Mosconi qui signe la préface, ce livre se lit comme un roman.
Pourtant le sujet est tout sauf sexy : la situation des femmes en formation d’adultes, pas de quoi faire rêver. Edmée Ollagnier, chercheuse et militante, nous emmène malgré nous dans les dédales de mécanismes de pouvoir insoupçonnés entre les groupes de sexe en les démontant un à un, en ouvrant des portes sur la complexité de notre monde, en éclairant les fonctionnements de la famille, du couple, de la société, de l’économie, de la politique qui ont une action directe sur les femmes, sur toutes les femmes. Elle nous emmène en voyage sur tous les continents pour nous faire partager ses observations, ses analyses, ses expériences, et là tout s’explique : les rapports entre pays riches, pays pauvres, la mondialisation, les injustices, les inégalités ici et ailleurs, tout ce qui fait que ce monde ne tourne pas forcément rond. C’est en chaussant ses «lunettes du genre» qu’elle nous permet de mieux comprendre ce qui se passe au fond.
Parce qu’en écrivant ce livre, Edmée Ollagnier avait une idée derrière la tête : transmettre le réflexe genre à ses lecteurs-trices comme aux publics auquels elle est confrontée dans les formations d’adultes. Pour elle, nous ne sommes pas neutres mais empreint-e-s de notre construction sociale genrée. Et les formateurs-trices ont tendance à l’oublier, reproduisant ainsi discriminations et inégalités. Elle vise à les faire sortir de cette pseudo-neutralité qui visibilise avant tout le masculin. Alors faut-il former au genre ou genrer la formation ? pour reprendre une de ses questions de 2006. La posture féministe tend vers la deuxième option précisément parce que chacun-e porte son bagage plus ou moins sexué. Il s’agit de permettre aux acteurs-trices de la formation de sortir enfin de leurs schémas de pensée traditionnels stéréotypés qui pénalisent systématiquement les femmes.
Edmée Ollagnier recense des outils comme Redémarrer en France ou Equal-Salary en Suisse (qu’elle a contribué à mettre sur pied) qui donnent aux publics concernés de nouvelles perspectives personnelles et professionnelles. De l’alphabétisation à la formation continue en passant par l’insertion professionnelle, les multiples dispositifs sont ici décortiqués : à chaque fois, l’expérience et l’expertise de l’auteure permettent de dégager les points positifs, les points négatifs et les pistes pour améliorer l’ensemble. Véritable base pour les politiques comme pour les formateurs-trices et source d’information passionnante pour les autres, l’ouvrage tient ses promesses en offrant un large éventail de propositions pédagogiques pertinentes et inédites. Indispensable.
Femmes et défis pour la formation des adultes. Un regard critique non-conformiste, Edmée Ollagnier, L'Harmattan 2014, 258 pages.

Lola Lafon, jeune auteure et chanteuse d’origine roumaine est définitivement sortie de l’anonymat avec son livre consacré à Nadia Comaneci. Elle imagine un dialogue entre elle et Nadia, qui fut la plus jeune et talentueuse gymnaste de la seconde partie du siècle dernier.
Fiction ou réalité ? Lola Lafon répond clairement dans un article au journal Libération. Elle n’a pas voulu pas faire une biographie. Elle ne se complait pas non plus dans la simple condamnation d’un régime ubuesque, sous la houlette de Nicolae Ceausescu, «grand timonier» de la Roumanie. Au contraire, elle démonte le mécanisme d’une machine infernale tout en mettant en valeur l’aspiration de Nadia à vivre une expérience qui pouvait la sortir du destin imposé aux petites filles roumaines de son époque.
Lola Lafon a réussi l’exploit de ne pas tomber dans le voyeurisme et la banalité «people». Son livre est au contraire un encouragement, sur fond d’expression féministe et libertaire, à la longue et dure quête de la liberté, quel que soit le régime dans lequel on se trouve et quelle que soit l’époque que l’on puisse vivre. Il se lit très facilement et nous tient en haleine sans discontinuer.
Lola Lafon a fait tandem, au festival d’Avignon, dans une création, «Irrévérence (s)», qui exalte la liberté en faisant dialoguer le corps et les mots… avec la danseuse étoile de l’Opéra de Paris, Marie-Agnès Guillot… On aura compris. Elle persiste et signe, sur les planches cette fois, dans le concret de l’expression contemporaine.
Lola Lafon, La petite communiste qui ne souriait jamais, Actes Sud, 2014, 320 pages.

Depuis que le mot "queer" est devenu politiquement correct, mainstream et quasi fourre-tout bien commode, les minorités en tous genres peinent à s'en extraire. La normalisation et l'inclusion faisant son oeuvre, année après année, il perd peu à peu son pouvoir subversif. Au point que l'éditeur Phaidon publie "Art & queer culture", certain de sa démarche avant-gardiste, voire olé-olé à en juger par le sticker sur la couverture qui proclame "premier livre à étudier la critique et la théorie de l'art visuel queer". Tout un programme !
Les auteurs, Catherine Lord et Richard Meyer, universitaires états-uniens spécialistes du genre, se sont penchés sur la porosité de la définition du "queer". En commençant leur introduction par cette phrase "I am your worst fear. I am your best fantasy", tirée des slogans des mouvements de libération homosexuels des années 70, ils posent le contexte… et le doigt là où ça chatouille. L'ouvrage ne recense pas exclusivement les artistes qui s'identifient comme homosexuel-le-s mais explique également comment les codes et les cultures de l'homosexualité ont constitué de la matière créative aux artistes. A ce titre, le lien politique/sexualités prend toute sa dimension, de même que le dialogue théorie/pratique, sans cesse rappelé par les auteurs.
Troubler le genre et les sexualités, éclairer les aspects performatifs des identités, s'opposer à la normalité ferait partie inhérente de la flamboyante de l'artiste queer, marque déposée depuis la fin des années 80. Certes, mais comment se fait la sélection pour intégrer ce premier livre sur l'art queer? Parce que même Sharon Hayes dans sa performance de 2008 intitulée Revolutionary Love 1 (I am your worst fear) et Revolutionary Love 2 (I am your best fantasy) avait une liste à rallonge pour recruter des participant-e-s queer pour son projet. Inclusif jusqu'où le queer ? On mesure à quel point l'exercice est difficile. Les quelque 400 pages d'Art & queer culture oublient nombre d'artistes essentiel-le-s. Le média papier en explique sûrement la limite physique. Et puis se posent d'autres questions : qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui reste de la sous-culture ? Catherine Lord et Richard Meyer proposent 220 pièces qui retracent 125 ans d'une histoire de l'art des cultures queer qu'ils sont les premiers à écrire. C'est certes un début en terme de visibilité et de reconnaissance mais la puissance subversive s'expose-t-elle dans les musées et les galeries? A quand le top 100 des meilleur-e-s artistes queer chez Taschen?
Les questions que soulèvent le livre méritent qu'on s'y intéresse et donnent des pistes pour les esprits curieux, les genristes et les passionné-e-s d'art. Une ressource à l'évidence.
Art & queer culture, Catherine Lord et Richard Meyer, Ed Phaidon, 412 pages.

Née en 1974 à Québec, Andrée-Marie Dussault est journaliste indépendante. Après avoir travaillé comme rédactrice en chef du magazine féministe suisse l’émiliE de 1999 à 2004, elle est partie à la rencontre de l’Inde de 2004 à 2011 et nous a rapporté des reportages saisissants dont elle a fait son premier livre.
C’est bien le contraire du folklore boollywoodien qu’elle nous présente à partir de ces dix-huit reportages auprès de femmes indiennes de toutes conditions, des vallées de l’Himalaya jusqu’aux plages du sud, au Kerala. De par la dureté de leur condition, les femmes indiennes n’ont d’autre choix que la résistance et l’héroïsme pour faire valoir leurs droits et marquer ce pays d’une empreinte incontournable.
C’est toute l’influence des femmes sur le mouvement d’une grande civilisation qui est mise en valeur à partir d’une expérience qui se veut modeste au regard de l’immensité d’un pays désormais peuplé d’environ 1,2 milliards d’habitants.
Sans concession et avec une grande précision, Andrée-Marie Dussault apporte sa pierre à la découverte d’un monde qui ne peut laisser indifférent alors même qu’il est confronté, sous les nuages d’un capitalisme ultralibéral particulièrement brutal, à de multiples défis environnementaux, économiques et sociaux. Des championnes de boxe aux écologistes aguerries en passant par les veuves abandonnées jusqu’à une Première ministre, les tableaux se succèdent et mêlent avec talent l’émotion et la recherche de la vérité.
Andrée-Marie Dussault, Voyage dans l’Inde des Indiennes, Ed. du Remue-ménage, 140 pages
]]>
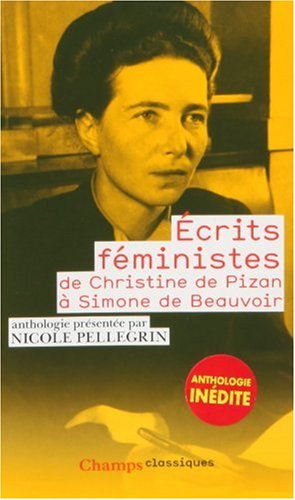
Nicole Pellegrin, anthropologue, est chargée de recherche honoraire au CNRS, spécialiste entre autres du rôle et des fonctions des femmes sous l’ancien régime. Elle réunit dans une passionnante anthologie quinze textes de personnalités féministes, allant de Christine de Pizan, auteure de La Cité des Dames en 1405, à Simone de Beauvoir, qui écrivit Le Deuxième Sexe en 1949, en passant par deux hommes, Nicolas de Condorcet, figure de la Révolution française et Charles Fourier, philosophe socialiste du XVIIIe siècle. Non seulement ces textes témoignent de la permanence du combat féministe qui ne se résume pas, loin s’en faut, au combat des suffragettes du début du XXe siècle, mais ils reflètent une richesse qui fera dire à Simone de Beauvoir en «conclusion» de l’ouvrage : «Un jour peut-être, la postérité se demandera avec la même stupeur comment des démocraties bourgeoises ou populaires ont maintenu sans scrupule une radicale inégalité entre les deux sexes. Par moments, … j’en suis moi-même ébahie. Bref, je pensais autrefois que la lutte des classes devait passer avant la lutte des sexes. J’estime maintenant qu’il faut mener les deux ensemble» (extrait de Tout compte fait, 1972).
Je conseille ce livre qui démontre que le combat féministe n’est pas celui de la «revanche», mais celui du combat pour l’égalité entre femmes et hommes, avec leurs différences, dans un monde débarrassé de la peste prédatrice.
Nicole Pellegrin
Ecrits féministes : de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir
Flammarion (coll. Champs classiques), 2010
250 pages

Après un essai qui donne une nouvelle lecture de Genet sur la performance de genre, Agnès Vannouvong se lance dans le roman. Une histoire de séparation, de la recherche insatiable du plaisir et de la jouissance à travers les métropoles de notre vaste monde. Pourtant après l'amour, le manque est toujours là. Mêlant brillamment romantisme et crudité, douceur et violence, Après l'amour, puisque c'est sont titre, est un roman sensuel et sexuel qui explore la fulgurance du désir féminin. l'émiliE a voulu en savoir plus. Interview.
l'émiliE: Après l’amour, c’est du vécu?
Agnès Vannouvong: Duras a cette phrase très juste, «ce sont toujours les autres, les gens qu’on rencontre, qu’on aime, qu’on épie qui détiennent l’amorce d’une histoire qu’on écrit. Il est stupide de penser, comme pensent certains écrivains, même les grands, que l’on est seul au monde». Qu’on le veuille ou non, on écrit à partir de soi, du réel, d’un événement, de quelque chose qui s’est passé, même si cette chose est étrangère à nous. Après l’amour est un roman, une fiction qui parle d’une chose intime et universelle : la rupture et la reconstruction. Il parle d’une femme prise dans une urgence, une quête de soi, une stratégie de survie post-amoureuse, un désir. Il parle de la vie, de vous et peut-être de moi. Qui n’a pas vécu après l’amour ?
Premier projet littéraire, première publication chez un grand éditeur, c’est déjà une réussite, non?
C’est une très grande satisfaction ! J’ai la chance d’être publiée dans une très belle maison et d’être bien accompagnée.
Votre personnage s’inscrit complètement dans les rapports sociaux de l’époque, avez-vous eu une approche sociologique dans votre écriture?
Je n’ai pas «d’approche sociologique» de la littérature. D’autres romanciers le font très bien. J’écris, c’est tout. C’est un souffle qui vient et ne s’interrompt pas, une apnée. Bien sûr, mon écriture construit des tableaux, parle d’une époque, s’ancre quelque part. Mon roman se déroule à Paris, il parle de l’extrême contemporain dans sa recherche frénétique et désespérée de sens. La narratrice travaille dans ce qui s’apparente à un Institut d’histoire de l’art. Je connais bien le milieu de la recherche que je me suis amusée à observer, par le prisme de cette jeune femme. L’écriture permet de mener plusieurs existences. On vit davantage quand on écrit, on est à plusieurs endroits. On est ailleurs, on se frotte à d’autres que soi. Je trouve merveilleux d’inventer d’autres vies que la sienne.
Vous enseignez à Genève, pourquoi ce choix?
C’était une opportunité. Je travaille sur les problématiques de genre et de sexualité, dans une perspective littéraire et esthétique. Ces questions transdisciplinaires me passionnent et j’ai un grand plaisir à travailler avec les étudiants, eux-mêmes très réceptifs aux questions identitaires qui nous concernent tous. Il est essentiel de repenser et déconstruire les stéréotypes en tout genre. J’ai d’ailleurs publié un essai Les revers du genre, Jean Genet. Il porte sur ces identités mouvantes qui circulent et déconstruisent nos imaginaires.
Après l'amour, Agnès Vannouvong, Ed. Mercure de France, 2013.
© Photo Stéphane Haskell
]]>

Il aura fallu cinquante bonnes années pour que la mémoire de la Maternité d’Elne, charmante petite ville située près de Perpignan, sorte des cartons de l’indifférence. Certes, des historiens avaient évoqué brièvement son existence, mais de manière anecdotique et il aura fallu qu’un certain Guy Eckstein, enfant juif né en 1940, apprenne qu’il avait vu le jour sous la protection d’Elisabeth Eidenbenz, directrice de la maternité, pour qu’il se lance à sa recherche. Il la retrouva dans un domicile qu’elle habitait à Rekawinken près de Vienne en Autriche où elle vivait avec une amie, Henrietta, qu’elle appelait affectueusement Lleti. Elle termina sa carrière dans l’humanitaire dans une association qui s’occupait d’enfants autrichiens.
C’est à ce moment-là qu’on pourra remonter le fil d’une aventure extraordinaire autant qu’émouvante. Elle s’est éteinte en 2011 dans une maison de retraite à Zurich après avoir été gratifiée de toutes les décorations, en France comme en Espagne, de la Croix de San Jordi à la Légion d’honneur.
Elisabeth Eidenbenz aura permis de faire naître et sauver des centaines d’enfants de la «Retirada» ainsi que, par la suite, des enfants juifs qu’elle aura su extraire du génocide entre 1939 et 1943. Etant obligée de fermer la maternité sous la pression des Allemands en 1944, elle repartira en Suisse et, pendant la période de la libération, participera au sauvetage de femmes qui subirent sévices et viols pendant l’arrivée des troupes soviétiques qui ont amené à la débâcle définitive des nazis en Autriche en 1945.
Imaginons Elisabeth, jeune infirmière suisse, issue d’un milieu chrétien protestant, allant secourir des vies en 1937 à Madrid puis à Barcelone, alors que les troupes fascistes menées par Franco assassinaient la République et poussaient à la fuite vers la France des centaines de milliers celles et ceux qu’elles n’avaient pas eu le temps d’anéantir. Ce fut, plus que de l’humanitaire, un défi à la barbarie, jusqu’au bout du voyage, en donnant raison à la vie.
Deux livres ont été publiés sur la Maternité d’Elne. Le premier La Maternitat d’Elna, en catalan, par Assumpta Montellà, historienne catalane, qui eut le mérite de faire connaître cette histoire forte et, plus récemment, le second Femmes en exil, mère des camps, de Tristan Castanier i Palau, jeune historien français, qui travailla en relation avec l’association D.A.M.E, association des descendants et amis de la Maternité d’Elne, et avec la municipalité d’Elne.
Ce dernier livre, le meilleur moyen de se le procurer, c’est bien d’aller visiter la maternité d’Elne, que la municipalité a rachetée pour en faire non pas un simple musée mais un lieu d’activité solidaire et de témoignage vivant de l’Histoire, en exemple à tous ceux qui sont épris de paix et d’humanité en ce monde.
Des milliers de visiteurs y sont déjà passés et il n’y a pas, dans la cité catalane, une seule pierre de la ville qui désormais ne nous fasse pas respirer ce printemps de la vie qu’Elisabeth a su mettre en musique à partir d’une organisation efficace, au nez et à la barbe des fossoyeurs qui ont laissé mourir dans le dénuement le plus total des milliers de réfugiés. Ils ont été jetés sur la plage, sans eau potable, sans hygiène, subissant le froid de la tramontane, obligés d’enterrer leurs morts dans le sable, derrière des barbelés hâtivement posés et gardés par les autorités françaises. On appelait ces lieux «camps de concentration», qu’on rebaptisera post-mortem «camps d’internement» pour ne pas les confondre avec les camps d’extermination nazis. La nuance existe certes, mais l’établissement de paliers dans l’horreur ne peut faire oublier la définition de l’époque.
Une presse hystérique citée dans un livre écrit en 1981, Camps du mépris, de René Grando, Jacques Queralt et Xavier Febrès, rappelle les dangers de la xénophobie :
«La France peut-elle continuer, dans les graves circonstances actuelles, d’être le refuge prédestiné de ces populations pitoyables mais pour une grande part indésirables… Qu’il s’agisse de vols, d’escroqueries, de cambriolages, d’attaques à mains armées, de trafic de stupéfiants, de traite des blanches, d’avortements, d’abus de confiance, plus de la moitié de ces crimes sont perpétrés par des étrangers.» Le Courrier de Céret (26.8.1939)
C’est dans cette ambiance délétère qu’Elisabeth Eidenbenz a acheté, pour le compte de la Croix Rouge suisse, cette demeure bourgeoise qui n’avait jamais été habitée et qui, dans sa destinée, ne le sera qu’en tant que maternité. Nous ne savons que peu de choses de la chaîne de solidarité qu’elle a dû construire pour braver les autorités en place. Les archives en diront certainement plus en regard de la discrétion compréhensible autant que par la disparition des témoins.
En attendant, le résultat est saisissant : 597 naissances ! C’est ce qui fait dire à Serge Barba, née le 12 avril 1941 à Elne : «Ma mère m’a donné la vie à la maternité suisse d’Elne et Elisabeth Eidenbenz la confiance au genre humain.» Autant dire qu’aujourd’hui sont nés beaucoup d’enfants auxquels on aura donné le nom d’Elna, comme le prolongement heureux d’un devoir de mémoire au cœur de la vie de chacun.
Le livre de Tristan Castanier i Palau regroupe 800 photographies de l’époque qu’Elisabeth a léguées à la municipalité d’Elne.
Les photos d’Elisabeth ont aussi montré la vie quotidienne de la maternité qu’elle a ainsi décrite : «Notre maternité d’Elne, située au milieu des champs fertiles entre les Pyrénées, et où la cigogne de notre enfance descendait souvent plus d’une fois par jour par la cheminée pour y déposer un joli bébé rose, représentait pour de pauvres femmes réfugiées un oasis de paix et de bien-être pour les 6 à 8 semaines pendant lesquelles elles étaient hébergées. Tout autour naissait la plaine rose des fleurs de pêchers…»
Grâce à son réseau solidaire, Elisabeth développera aussi une énergie farouche pour aider les internés du camp d’Argelès à tenir le coup, en permettant de gros efforts d’introduction de l’hygiène pour freiner la propagation des épidémies. Autant de vies aussi sauvées en plus de la naissance des enfants de la maternité.
Elna, citoyenne du monde
A la mairie d’Elne, une exposition permanente sur la maternité peut être visitée, avec une lettre écrite par Jean Ferrat, qui fut son parrain. Autant dire que la fierté de Nicolas Garcia, qui nous a reçus, est bien méritée. Après avoir mené à bien un projet ambitieux qui n’était pas si facile à réaliser, vu les moyens à mettre en œuvre, mais aussi parce que la mémoire de cette période rappelle souvent plus le froid de l’hiver que la douceur du printemps, Nicolas Garcia a fait le choix de l’avenir en initiant le projet d’un centre de formation pour des jeunes qui veulent œuvrer dans l’humanitaire, en collaboration avec des ONG. Il a aussi obtenu que la maternité soit classée monument historique et agit maintenant pour que l’Unesco la classe comme patrimoine de l’humanité.
«Quoi de plus beau, nous dit-il, que de prendre appui sur un exemple extraordinaire de solidarité humaine aboutissant à la naissance de centaines de vies pour inciter à l’action, ne serait-ce que pour ne plus jamais voir s’abattre une nouvelle fois sur l’humanité la tempête de la barbarie.
Ainsi, à la maternité d’Elne, nous abriterons un centre de recherche sur l’activité humanitaire en Europe au XXe siècle, une auberge humanitaire. Nous avons aussi le projet d’offrir de courts séjours de réhabilitation offerts à des mères et leurs enfants en très bas âge qui n’empêcheront pas la tenue de conférences et colloques.
Autant dire que tout cela ne peut pas se faire sans la collaboration de toutes les bonnes volontés et en particulier l’activité de l’association D.A.M.E. dont François Charpentier, malheureusement décédé, fut la cheville ouvrière et à qui nous devons d’avoir pu rénover ce magnifique lieu de mémoire et d’espoir qu’est la Maternité d’Elne. »
Pour en savoir plus :
Tristan Castanier i Palau : Femmes en exil, mères des camps.
Violette Marcos et Juanito Marcos : Les camps de Rivesaltes.
Geneviève Dreyfus-Armand : Les Camps sur la plage, un exil espagnol
]]>
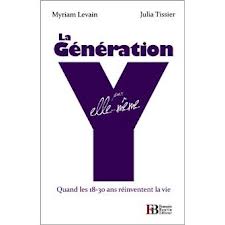
Vous avez entre 50 et 70 ans ? Vous êtes parents de jeunes âgé-e-s de 18 à 30 ans ? Vous les trouvez individualistes, insolents, instables au boulot, indécis en amour, dopés au porno, «ils ne croient plus à rien», «ils ne votent pas», «ils brûlent des voitures», «ils sont incultes», «ils veulent tout, tout de suite», «ils boivent et ils se droguent», «ce sont de grands enfants», c’est ce que vous pensez tout bas et dites parfois tout haut ? Alors La génération Y par elle-même est le livre qu’il vous faut pour décrypter cette jeunesse dont vous êtes déçu-e-s et croyiez tout connaître !
J’étais comme vous, partagée entre colère, incompréhension, frustration, curiosité et désir de comprendre. Les auteures sont de cette génération-là et, à force d’entendre les stéréotypes collés à leur groupe d’âge, elles ont voulu en avoir le cœur net, ont interrogé nombre de leurs contemporain-e-s, ainsi que des chercheurs et chercheuses éminent-e-s en sciences sociales, pour arriver à nous présenter «leur» version des choses, qui est, ma foi, très intéressante et qui devrait nous rendre plus tolérant-e-s envers une population qui nous semble parfois étrange et proche à la fois…
Savez-vous ce que veulent dire les mots geek ou poke ou taguer ? Un petit glossaire à la fin du livre vous éclairera. Apprendre l’italien ou le russe, c’est utile, mais connaître la langue de nos jeunes adultes, ça l’est aussi !
Bien du plaisir !
Myriam Levain et Julia Tissier
La génération Y par elle-même : quand les 18-30 ans réinventent la vie
François Bourin Editeur, 2012
201 pages
]]>
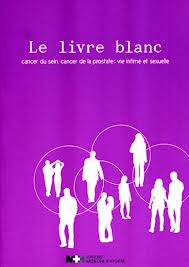
Ce livre est une mosaïque de multiples apports, tous fort éclairants, jamais déconnectés du réel, et parfois même poétiques. Des explications anatomiques, des exemples de questionnements lors d’ateliers d’échange, de nombreux témoignages, quelques contributions théoriques de spécialistes, mais aussi leurs interrogations, leurs doutes.
Mais d’abord, ce livre est en quelque sorte un hymne à l’amour ! Alors qu’il traite d’un sujet éprouvant, difficile, n’est-ce pas faire preuve d’un angélisme déplacé ? Nullement ! Les témoignages frappent par leur authenticité, leur franchise. On est si près de la douleur, de l’appréhension, de la détresse de toutes celles et de tous ceux qui ont accepté de prendre la plume pour raconter leur rapport au corps mutilé et surtout les nouvelles relations à l’autre, qu’on doit assumer ensemble. «Les femmes atteintes par le cancer du sein ont raconté avec beaucoup d’hésitation le traumatisme vécu au moment de révéler leur cicatrice dans leur couple. Ma compagne et moi avons fait quelque chose de positif, parce qu’un jour elle est sortie de la douche en ma présence avec un sourire plein de tendresse. Dans un sens, c’est elle qui m’a soulagé !»
Les réflexions des médecins ou psychologues spécialistes sont elles aussi marquées par le désir constant de mieux comprendre ces malades, afin de leur répondre différemment en prenant en compte leurs besoins émotionnels, et pas seulement physiques.
Ce livre blanc (qui comporte certaines pages blanches, invitant la lectrice, le lecteur à consigner ses idées, à prendre donc aussi la plume) représente une magnifique contribution à la problématique de ces maladies encore si mystérieuses.
Collectif
Le livre blanc. Cancer du sein, cancer de la prostate : vie intime et sexuelle
Ed. Médecine et Hygiène, 2012
247 pages
]]>
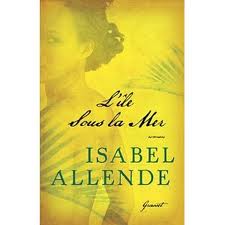
Isabel Allende, nièce de Salvador Allende, notre regreté président du Chili, est une grande écrivaine de cette culture latine autant créative, pathétique que chaleureuse. Nous atterrissons à Saint-Domingue, en 1770 pour finir en 1810 en Louisiane. L’auteure nous livre le roman historique de l’état esclavagiste aux Caraïbes au travers de la destinée d’une femme, Zarité, dite Tété, qui suivra son maître à la Nouvelle-Orléans, un colon français, Toulouse Valmorain. Celui-ci échappe à une révolte qui va aboutir à la première révolution d’esclaves dans le nouveau monde.
L’intérêt de ce livre tient à cet heureux mélange de la passion amoureuse, de la lutte pour la liberté, dans le décor des plantations de canne à sucre et des maisons de jeu de la Nouvelle Orléans, des demeures de maîtres aux bordels des mulâtresses.
L’ouvrage est certes volumineux, mais il est suffisamment ciselé de courts chapitres pour permettre aux lectrices et lecteurs d’avancer à leur rythme sans avoir à s’essouffler, voire revenir à des pages qui peuvent se relire avec délice. Ce qui ressort le plus, c’est la force de l’amour, dans l’expression de la passion et de la tendresse, qui crée un contraste saisissant avec l’intensité de l’horreur que vivent les esclaves, réduits à un état que même des animaux domestiques ne vivent pas.
C’est aussi l’hommage rendu à une femme qui a eu le courage, malgré tout ce qu’elle a vécu de violences et d’humiliations, d’atteindre l’état de liberté, non pas seulement celui de l’affranchissement, mais avant tout celui de l’esprit, qui permet de tracer la route de l’émancipation humaine. Un beau livre et un message d’espoir. Une leçon de patience et de ténacité, utile par les temps qui courent.
Isabel Allende, L’île sous la mer, Ed. Grasset 2012, 524 pages.
]]>

Marion Gillot est une jeune journaliste, rédactrice à Fleurus Presse, filiale du Monde spécialisée dans la presse à destination des adolescents. Son complice et talentueux illustrateur Nicolas Wild est un passionné d’histoires à raconter en bandes dessinées, les plus connues étant celles sur l’Iran et l’Afghanistan. Elle publie ce livre pédagogique sur les métiers de la presse tels qu’ils existent et se pratiquent aujourd’hui, quel que soit le support employé, presse écrite, radio ou audiovisuel.
Certains pourraient dire que cet ouvrage est un exercice de style réservé aux adolescents en mal de vocation. A y regarder de plus près en tournant les pages d’un abécédaire autant pétillant qu’instructif, l’exercice va plus loin. Tout d’abord parce qu’il exprime la façon de vivre et de penser de toute une nouvelle génération de journalistes qui se posent plus la question du traitement de l’information que de l’évolution de ses supports, même si cela peut lui poser question, mais aussi parce qu’il met à jour, et sans concessions, à partir d’exemples types bien répertoriés, le rapport du monde de la presse avec la société.
Chaque démonstration est suivie d’un encadré imprimé en couleur «Et toc», qui donne des indications complémentaires utiles. Dans ce chemin de fer qui sent bon le printemps, on va s’arrêter à la lettre J comme Jeunesse et apprendre que les bambins d’aujourd’hui seront de grands lecteurs des journaux de demain ! Une bonne nouvelle à confirmer à ceux qui pensent que les carottes sont cuites, à un moment où la presse d’opinion est si mal menée par les casseurs de la finance.
A mettre dans les mains de TOUTES les générations !
Marion Gillot, Les dessous de la presse
Ed. Gulf Stream, 2012
230 pages
]]>

A partir de la thèse selon laquelle le but de l’homme est de happer la femme dans son regard pour la soumettre, la grande écrivaine décrit les ravages du patriarcat dans le monde actuel à travers les industries du sexe : la cosmétique (les milliards de L’Oréal !), la pornographie et la prostitution. Inspirée par la philosophie de Nelly Arcan, une jeune prostituée américaine suicidée, et par des biographies de femmes trop belles et trop désirées comme Marilyn Monroe, elle conteste radicalement la banalisation de la prostitution. Bien documentée, bien argumentée, cette partie du livre est très forte.
Dommage que Nancy Huston s’attaque aussi aux Etudes genre, faisant croire que cette approche culturelle est une idéologie totalitaire ! Alors que les Etudes genre ont toutes les peines du monde à se faire accepter, respecter et financer au sein des universités, les fustiger comme un «dogme dominant» est ridicule, surtout de la part d’une écrivaine aussi documentée.
Nancy Huston, Reflets dans un œil d’homme
Ed. Actes Sud, 2012
250 pages
]]>

Comment et pourquoi devient-on lesbienne et révolutionnaire quand on a été élevée, fille de militaire et petite-fille d’entrepreneur, dans une famille patriarcale d’avant 1968 ? Claire Sagnières, dans son troisième livre, recherche les sources de sa révolte. Ce que les bourgeois détestent par dessus tout, c’est parler d’argent, du sexe et de la mort, et ce livre ne parle que de cela ! Recherche exigeante, lucide et passionnante, d’autant plus que Claire, après une jeunesse française, est devenue une des leaders féministes du MLF genevois, cofondatrice du premier journal lesbien CLIT007 et coorganisatrice de magnifiques manifestations. Si le livre s’arrête avant Genève, on peut prolonger l’histoire en consultant le site www.clit007.ch où Claire a rassemblé les numéros du journal paru entre 1981 et 1984, ainsi que des émissions radio lesbiennes sur Radio Pleine Lune et Radio Pirate. Des temps forts de l’histoire du féminisme genevois à (re)découvrir, en attendant le prochain livre !
Claire Sagnières, Concentré lesbien irrésistiblement toxique
Ed. Le Manuscrit, 2012
314 pages
]]>

Gérard Mordillat, écrivain et cinéaste, a déjà écrit de nombreux livres dont La Sociale et réalisé une vingtaine de films. Son dernier roman, Ce que savait Jennie, sonne comme une hache qui brise les vies pour alimenter les feux de l’injustice.
Enfant d’une passion incestueuse entre sa mère Olga et son oncle, Jennie collectionne les mauvais plans et se retrouve toujours enfoncée dans le trou d’un puits au moment où elle tente de s’en sortir.
Après avoir résisté à des tragédies à répétition, elle vit une belle histoire avec un jeune homme, Quincy, acteur, qui organise le scénario de la vengeance d’une mère ayant mis fin à ses jours, ne supportant pas d’être mise à la porte de son entreprise.
La seule lueur d’espoir de Jennie, pour briser l’étau de ses souffrances, c’est son projet d’atteindre les falaises d’Etretat où elle essaie d’amener une de ses sœurs. Elle n’atteint pas son but, clouée au sol de l’acharnement du sort, par le passage à l’acte de Quincy, dans un feu d’artifice macabre, crime parfait, œil pour œil – dent pour dent.
Le dernier cri de Jennie «C’est trop injuste» nous donne le goût amer de la révolte sur un fond d’incendie volontaire et de sang versé qui pique nos yeux et nous étouffe.
De l’exagération ? Oui, et c’est tant mieux, si on considère qu’un ouvrage n’a de valeur que s’il sait faire vibrer les sens par delà le réel. Non, si on accepte que notre société regorge de ces situations violentes réservées à tant d’êtres humains condamnés d’avance à vivre une destinée mortifère.
L’écriture de Gérard Mordillat fonctionne comme une irruption volcanique qui se prépare à jaillir des entrailles d’une humanité qui n’a pas changé fondamentalement ses règles cruelles, depuis les mines de Germinal.
Un beau livre aux fruits de la passion, loin du miroir aux alouettes de papa Noël.
Ce que savait Jennie, Gérard Mordillat
Calmann-Lévy, 2012
222 pages
]]>

Ce travail n’est pas la simple élucidation d’un concept ou d’une théorie. Il veut aller plus loin, faire connaître une façon d’être, de vivre. Le pornoterrorisme dérange, dépasse toutes limites, déconstruit sans forcément reconstruire.
Ce livre est un récit biographique et une réflexion sur le sexe et les pratiques sexuelles, la morale, la politique... Un appel à briser les tabous dominants de notre société. Un attentat aux conventions, un acte terroriste contre les normes. «Y a-t-il fusion plus belle que celle des mots porno et terrorisme ?». Le livre préfacé par Annie Sprinkle et Beth Stephens, de quoi placer la barre assez haut!
Née à Madrid en 1981, Diana J. Torres, diplômée en philologie hispanique à l’université de Barcelone, est une artiste multidisciplinaire utilisant la performance, la poésie, la vidéo et la pornographie-postpornographie. Elle organise des shows où le public est poussé, d’une certaine manière, à l’implication émotionnelle, politique et sexuelle. Depuis 2006, son travail s’axe surtout sur le pornoterrorisme, mouvement qui s’étend à travers la toile : www.pornoterrorismo.com.
A découvrir absolument.
Pornoterrorisme de Diana J. Torres
Editions Gatuzain, 2012
ISBN : 978-84-8136-609-9
(Contact éditeur: Gatuzain Argitaletxea BP 454 64504 AZKAINE CEDEX France email:[email protected])
]]>
Hélène Cooper est journaliste au New York Times, elle a donc acquis un poste professionnel prestigieux, mais son itinéraire ne fut pas simple : elle raconte dans ce livre comment elle, petite Africaine née au Libéria dans le milieu privilégié des Congos, a rejoint l’Amérique en 1980, fuyant la guerre, et a ainsi pris conscience des clivages sociaux et racistes, qui perdurent avec tant de force.
Le Libéria, hier et aujourd’hui
On découvre ainsi, d’une manière sensible et originale, l’histoire du Libéria, ce pays créé de toutes pièces. Hélène Cooper construit son livre en intercalant des documents historiques relatant l’épopée de ses ancêtres qui se trouvaient «sur la version libérienne du Mayflower, le premier bateau de Noirs affranchis qui quitta le port de New York en 1820.» 160 ans plus tard, les habitant-e-s autochtones du Libéria se révoltent contre ces colonisateurs d’origine noire et américaine. S’en suit une guerre atroce et fratricide qui va ensanglanter le pays. Hélène, enfant puis adolescente, vivra les prémices de cette révolte sans vraiment la comprendre, croyant que son amitié avec Eunice, la jeune fille indigène modeste qui vit avec eux, la protégera des violences qui grondent dans la ville. Mais le 12 avril 1980, un coup d’Etat fracassant signe la fin de son existence de jeune fille protégée et naïve. La famille Cooper doit s’exiler aux USA et Hélène, à son tour, fera face à la pauvreté et à l’exclusion.
Retour aux sources
Après bien des années passées à voyager comme grand reporter, Hélène Cooper retourne dans sa patrie africaine, retrouve ses racines, et des souvenirs tant amers, honteux, douloureux que délicieux. C’est dans ce terreau exceptionnel qu’elle puise pour écrire un récit très émouvant et libérateur.
Hélène Cooper
La maison de Sugar Beach : réminiscence d’une enfance en Afrique
Traduit de l’anglais par Mathilde Fontanet
Ed. Zoé, 2012 365 pages
]]>

Que sait-on vraiment de la vie et de l’œuvre d’Hypatia, cette figure mythique née à Alexandrie au 4e siècle après J.-C. ? Peu de choses en vérité. Pour compléter les traces ténues laissées par cette philosophe et mathématicienne sans nul doute très douée, Olivier Gaudefroy s’est intéressé de près aux œuvres et essais des savants de l’époque, contemporains et collaborateurs d’Hypatie.
On saisit donc fort bien, dans cet opuscule intéressant et précis, la mentalité des intellectuels de l’époque et on comprend l’originalité de cette femme exceptionnelle et dérangeante pour les édiles de la cité. Fille unique d’un savant mathématicien, elle assuma très jeune la charge de cours publics d’algèbre, d’astronomie et de philosophie. Elle ne s’intéressait qu’à la science, refusant la condition habituelle des femmes de l’époque : le mariage et la tutelle du mari. Elle n’adhéra pas à la religion chrétienne, voulant absolument garder son indépendance de libre-penseuse philosophe.
Sa mort atroce (elle fut littéralement mise en pièces par une milice à la solde du patriarche chrétien Cyrille) confirme d’ailleurs bien à quel point il était difficile de se faire une place en tant que femme indépendante et savante.
Hypatie vient du mot grec hupatos, qui signifie «le plus haut». Nom prédestiné, qu’elle paya fort cher.
Olivier Gaudefroy
Hypatie : l’étoile d’Alexandrie
Ed. Arléa (coll. Post Scriptum), 2012
136 pages
]]>

Née en 1944, Noëlle Châtelet, universitaire et écrivain, vit à Paris. Elle nous livre ici le dialogue intime de deux générations qui tissent un pont magique entre hier et demain.
«Je suis grand-mère, ma mère, pour admirer le ricochet des ces petites pierres vermeilles sur l’étendue de la mémoire. Les regarder bondir. Rebondir. Je me dis : un jour, les ricochets se feront sans moi, mais la pierre que j’ai été sera de la partie.» Mano, c’est le nom créé pour la circonstance d’une situation ô combien ordinaire, que l’expression des sensations sublime au point de nous donner à tous l’envie d’être grand-mère, même à nous, les hommes. Délicatesse d’un style où la sensualité et le dynamisme expriment la noblesse d’un sens inné de la transmission. Expression d’un bonheur parfait qui ne sent pas l’ennui parce que l’émotion est reine à chaque moment d’une existence volée au couperet d’un temps qui passe trop vite.
«Tu me regardes pour savoir s’il faut rire. Je ris. Je ris parce qu’une fourmi qui tombe sur le derrière, c’est drôle.» Ce livre est un hymne à la soif de vivre ensemble, de la vieillesse à la petite enfance et inversement. A ne pas manquer.
Noëlle Châtelet
Au pays des vermeilles
Ed. Points, 2010, 170 p.
]]>

66 manifestations en 600 slogans et 100 photographies ouvrent la boîte à souvenirs de 40 ans d’histoire du féminisme en France. Slogans, photos et textes ont été rassemblés par Anne-Marie Faure-Fraisse, cinéaste, Lydie Rauzier, Corinne App, graphiste et le résultat est un très beau livre fuchsia, véritable objet d’art, doux au toucher que l’on s’empresse de feuilleter dans tous les sens ! C’est que les slogans – «trésor du féminisme» – font appel à tous les jeux de langage, usant du paradoxe, de formules et d’images choc, de l’humour, de l’insolence, de la provocation et de la violence. Ils vont trouver toutes les expressions possibles, pancartes, panneaux, banderoles, marionnettes, ballons et chansons.
Manifester est un acte important. S’il renforce la détermination des militantes et la préparation de la manifestation, la confectionde banderoles, le fait de faire des choses ensemble peut contribuer à «changer la vie entière».
On peut débattre sur la date exacte de la naissance du Mouvement de Libération des Femmes, mais «la première grande manifestation, historique, est celle du 20 novembre1971. Elle a pour objectif que le débat sur l’avortement et la contraception soit pris en main par les femmes elles-mêmes. Pour le MLF naissant, c’est sa première épreuve militante». Depuis, le féminisme a évolué et «se distingue par la multiplication de groupes centrés sur des thématiques spécifiques» : port du voile, droits des homosexuelles et des transgenres, etc. De plus, il s’internationalise ; la Marche mondiale des femmes, qui a lieu tous les 5 ans, en est un exemple.
Connus ou découverts lors de la lecture, tous ces slogans mériteraient d’être cités ! N’en retenons qu’un seul «C’est en slogant que l’on devient féministe» (2010) et insistons sur le fait ce que ce petit ouvrage n’est pas qu’un livre d’images, mais un vrai livre d’histoire dont la forme est bien dans l’esprit qui animait toutes ces manifestations!
Collectif
40 ans de slogans féministes, 1970-2010
Editions iXe, 2011, 243 p.
]]>

Cette enquête se lit comme un roman ! On plonge dans un monde particulier à deux faces : le côté cour, investi par les nounous africaines venues de Côte d’Ivoire, qui gardent les enfants le jour, quand les mères (et pères) travaillent, et le côté jardin, représenté par les jeunes couples reprenant la garde des enfants la nuit et le week-end.
Les nounous vont au parc, les jeunes parents décorent leur bel appartement. Mais que font les nounous quand elles rentrent chez elles ? Et en fait, où habitent-elles ? Ont-elles des papiers ? Envoient-elles de l’argent en Afrique ?
Et les mères employeuses ? Se sentent-elles coupables de laisser leurs enfants tant aimé-e-s, tant désiré-e-s auprès de femmes qu’elles ne connaissent pas vraiment ? Ont-elles la liberté d’esprit suffisante pour assumer des tâches professionnelles importantes et complexes ?
Caroline Ibos a fait un immense travail d’enquête pendant trois ans, en interviewant 21 familles et 13 nounous. Elle a réussi à comprendre le travail et l’engagement de ces dernières en passant de nombreuses journées avec elles, au parc. Mais elle sait aussi donner la parole aux mères employeuses, qui expriment fort bien la complexité de leurs choix.
«Une bonne nounou, c’est une nounou qui ne fait pas ce travail que pour l’argent». Oui, mais pourtant ? La nounou a besoin de son salaire, et l’employeuse a besoin d’une personne qui se dévoue… Comment concilier ces points de vue, ces besoins ?
Une mine de réflexions intéressantes, qui intègrent à la fois la sphère de l’intime et la logique de la mondialisation.
Qui gardera nos enfants ? Les nounous et les mères
Caroline Ibos
Ed. Flammarion 2012
]]>
L’association Mnémosyne, constituée d’historiennes et d’historiens, de chercheurs, chercheuses, enseignant-e-s, attaché-e-s à la transmission des savoirs sur l’histoire des femmes et du genre, nous propose un magnifique manuel, richement illustré et qui tente enfin de combler (partiellement) les lacunes des programmes habituels.
On y trouvera un éventail très intéressant de différentes époques, des mondes antiques et médiévaux, aux temps modernes, à l’âge industriel, et plusieurs chapitres spécifiques du XXe siècle, traitant bien entendu de la condition des femmes en choisissant quelques personnalités marquantes. Chaque partie comporte une explication détaillée, des choix iconographiques originaux, un petit questionnaire pédagogique. Connaissez- vous Aspasie, Ban Zhao, ou Alexandra Kollontaï ?
On ne peut que souhaiter que les collèges romands proposeront ce manuel à leurs élèves, filles ou garçons !
La place des femmes dans l’Histoire : une histoire mixte
Geneviève Dermenjian, Irène Jami, Annie Rouquier, Françoise Thébaud
Ed. Belin 2010
]]>
Vous avez peut-être assisté à une représentation ou entendu parler des Monologues du vagin ces dernières années, ils ont fait le tour du monde. Eve Ensler revient avec une nouvelle œuvre forte à lire, réciter ou jouer. Elle y célèbre la voix authentique qui se trouve en chaque jeune fille, vibrante et passionnée, mais qui peine à s’exprimer devant les attentes de la société, si éloignées des vrais besoins de ces jeunes femmes qui voudraient explorer, s’indigner, sortir des chemins battus. Mais elles sont encouragées à plaire, à se conformer, à obéir aux règles. Comment font-elles pour survivre, ces adolescentes anorexiques qui rêvent de manger, ces petites prises de force à la guerre ou mises sur le trottoir des capitales, qui rêvent d’être à l’école, ces ouvrières à la chaîne de montage des Barbie, qui rêvent de peindre ou de chanter ? Parfois, elles dansent, elles dansent jusqu’à l’extase, jusqu’à l’oubli, pour que tous les rêves redeviennent possibles… D’elles-mêmes, elles disent : «Nous les filles sommes les ultimes survivantes».
Eve Ensler est fondatrice de V-Day, un mouvement mondial pour en finir avec les violences faites aux femmes. La pièce Je suis une créature émotionnelle a été créée à Johannesburg en juillet 2011. Eve Ensler vit entre New-York, Paris et l’Afrique.
Eve Ensler
Je suis une créature émotionnelle
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Alexia Périmony
10/18, 2011
]]>
14 mai 2011, coup de tonnerre dans tous les médias : le candidat favori pour la présidence de la République française est arrêté à New-York. L’homme blanc, riche et puissant est écroué pour violences sexuelles envers une femme noire, émigrée, travailleuse pauvre. La presse française et les caciques du PS s‘affolent et expriment à cette occasion leur mépris des femmes qui n’a d’égal que leur arrogance de classe. Comme l’écrit très bien Christine Delphy, «ce fut l’occasion pour beaucoup de dire tout haut ce qu’on ne croyait même pas qu’ils pensaient encore tout bas».
Cet ouvrage recueille les réactions des féministes, très rapides, après la nouvelle stupéfiante. A l’encontre des socialistes qui défendent avant tout leur leader, les féministes descendent dans la rue dès le 22 mai et organisent leur riposte dans la presse. Peu à peu leurs arguments pour le respect et la liberté des femmes gagnent du terrain. Un Jean-François Kahn qui avait sorti cette scandaleuse expression «Ce n’est qu’un troussage de domestique» recule et s’autoflagelle. Elles ouvrent les vannes de la parole des femmes. Des journalistes, des parlementaires osent enfin révéler le sexisme de leurs milieux, les couleuvres qu’elles se sentent obligées d’avaler pour garder leur place. Les femmes françaises acquièrent un nouveau regard sur la banalisation des violences sexuelles qu’elles ont dû subir et beaucoup rejoignent le combat féministe.
Alors que DSK et sa femme, figure emblématique de l’épouse idéale, se refont une carrière respectable, il vaut toujours la peine de lire la prose stimulante des meilleures Françaises, pour s’encourager à continuer avec elles les luttes féministes.
Un troussage de domestique
recueil de 23 contributions féministes, coordonnées par Christine Delphy
Ed. Syllepse, Paris, 2011, coll. «Nouvelles questions féministes»
182 pages
]]>
Ce roman féministe et militant met en scène quinze casseuses de cailloux dans une carrière au bord d’un fleuve africain. Elles apprennent que la valeur de leur marchandise a considérablement augmenté sur le marché et décident de revendiquer une augmentation du prix de leur sac de 10’000 à 200’000 FCFA.*
Pendant une dizaine de jours, à travers le récit de leur porte-parole Méréana, nous suivons cette lutte qui coûtera la vie à l’une d’entre elles. Si les négociations avancent et que les ministres s’en mêlent c’est qu’une réunion des femmes des présidents africains doit avoir lieu dans la ville. L’affaire prend vite un tour politique et les autorités essaient de l’étouffer avec une grosse enveloppe et des promesses de déclarations pro-gouvernementales aux médias. Mais ces militantes ont découvert leur pouvoir et tirent habilement leur épingle du jeu.
Livre magnifique : ces femmes aux destins cabossés, victimes de tous les maux de l’Afrique en développement, SIDA, machisme, mariages forcés, guerres civiles, viols, font preuve d’une solidarité, d’un dynamisme impressionnant et de la conscience qu’elles s’en sortiront par l’éducation et la formation professionnelle.
Emmanuel Dongala est un écrivain congolais et vit aux USA depuis la guerre civile de 1997.
*au cours du jours : 10’000 FCFA valent environ 15 euros
Photo de groupe au bord du fleuve
Emmanuel Dongala, Ed. Actes Sud, 2010, 334 pages
]]>

Cet ouvrage provient du blog Viedemeuf.fr lancé par l’équipe française de Osez le féminisme ! qui récolte depuis 2009 les réactions misogynes et les expériences sexistes de la vie ordinaire. Il a pour but de faire prendre conscience aux milliers d’internautes qui s’y connectent chaque jour que les inégalités sont encore présentes partout et de leur donner envie de s’engager pour faire changer la société. Les petites phrases assassines et tellement banales du quotidien – «Vous allez nous faire le café comme vous êtes la seule fille» – sont regroupées en une dizaine de domaines: profession, couple, ménage, maternité, éducation, langage, etc. Chaque chapitre privilégie la prise de conscience et donne des idées de répliques cinglantes : «Quoi, tu n’as pas encore d’enfants ? – Non, et toi, toujours pas de chien ?», ou de réponses plus étayées : «En moyenne, en France, une femme prend 32 semaines de congé maternité (deux enfants). Sur 2080 semaines d’activité. Ça fait relativiser.»
En fin d’ouvrage, une histoire des droits des femmes en quelques dates et des adresses d’associations féministes aident aussi à bien s’armer contre le sexisme ordinaire. Un petit livre à avoir toujours sur soi !
Vie de meuf, le sexisme ordinaire illustré
édité par l’association Osez le féminisme !
Préface de Catherine Vidal, neurobiologiste
JBz & Cie, Paris, 2011
]]> Avec son Petit traité de désobéissance féministe, Stéphanie Pahud, féministe et linguiste, nous livre les outils de base pour prendre du recul avec la «Femme» et l ’«Homme».
Avec son Petit traité de désobéissance féministe, Stéphanie Pahud, féministe et linguiste, nous livre les outils de base pour prendre du recul avec la «Femme» et l ’«Homme».
Comment? En décortiquant la manière dont la publicité et les médias reflètent les stéréotypes de genre en cours dans notre société.
Pourquoi? Pour une plus grande créativité dans nos identités et nos comportements.
Explications.
Pour la linguiste et féministe Stéphanie Pahud, la désobéissance passe par une prise de conscience des assignations de genre. Autrement dit, ne pas forcément se conformer aux comportements prescrits aux femmes et aux hommes selon leur sexe biologique. Ces stéréotypes de genre sont souvent sous-jacents aux discours et comportements ambiants. Ce sont des «évidences» qui naîtraient de la «nature» même des hommes et des femmes.
La publicité et les discours médiatiques mettent en scène, volontairement ou non, les stéréotypes de genre et représentent ainsi le corpus rêvé pour une linguiste qui tient à mettre à jour ces normes sous-jacentes. Il ne s’agit pas d’une dénonciation de la publicité et des médias, mais plutôt d’une prise de conscience individuelle pour une vieille critique des assignations. Afin que chacune et chacun puisse choisir avec plus de liberté les comportements qui correspondent à son identité, ses aspirations et ses incohérences.
«Le soin, par nature c’est elle… la précision, c’est Tefal.»*
Si la publicité est certes devenue bien moins directement sexiste, elle n’en demeure pas moins un discours qui perpétue encore souvent les stéréotypes de genre. En partie pour des raisons marketing, le discours publicitaire aime les catégories bien différenciées : «Sur le plan économique, le système de genre est au cœur du dispositif publicitaire: il intervient dans le segmentation des marchés, dans la sélection des médias et des supports, dans le packaging des produits, dans le choix des arguments de vente et, bien sûr, dans les scénarios des annonces qui, pour la plupart, mettent en scène des êtres humains.»
Si Stéphanie Pahud souligne la publicité est «perméable» aux évolutions, au queer ou au gay friendly - «Couples hétérosexuels, la MAIF vous assure aussi » - il n’empêche qu’au final, «la majeure partie des scénarios publicitaires sont aujourd’hui encore marqués du sceau de la division traditionnelle des rôles et des caractères féminins et masculins.»
La nuit des longues limes à ongles
Dans la presse, les femmes représentent le cinquième des personnes évoquées et le tiers des signatures. Outre ces chiffres, Stéphanie Pahud a choisi de décortiquer le discours sur les femmes politiques comme symbolique du rôle des médias «dans la formation et la perpétuation des imaginaires collectifs, entre autres de genre et [pouvant] contribuer, indirectement, à entretenir un verrouillage des identités féminine et masculine.»
Si, par exemple, le fait d’être une femme a souvent été positif dans la campagne à l’élection au Conseil fédéral de Doris Leuthard, on peut tout de même se demander si UN ministre de l’économie aurait été représenté en caissière par un dessinateur de presse. Quoi qu’il en soit, positif ou négatif, que Doris Leuthard soit une femme n’a pas été neutre dans les échos médiatiques de sa campagne et de son élection.
En somme, Stéphanie Pahud ne nie pas les différences biologiques entre les sexes mais questionne les déterminations sociales et culturelles qui en découlent. Les hommes et les femmes que nous sommes ne se reconnaissent pas forcément dans la masculinité ou la féminité présentée comme naturelle. Entre «socialisation et pouvoir de construction identitaire», la linguiste en appelle à notre pouvoir de créativité envers les normes sociales.
*Annonce publicitaire Tefal pour des appareils de soin pour bébé.
Stéphanie Pahud est docteure ès Lettres et maître-assistante en linguistique française à l’Université de Lausanne.
Petit traité de désobéissance féministe, édition Arttesia, 2011, 135 p.

Ce sont elles qui l'écrivent : Françoise Héritier l'anthropologue, Michelle Perrot l'historienne, Sylviane Agacinski la philosophe, et Nicole Bacharan la politologue. Avec humour et intelligence, nous revisitons notre histoire en nous la réappropriant au passage. Car depuis le début, même si les femmes font l'Histoire au même titre que les hommes, ce sont eux qui l'écrivent. L'époque est révolue. L'ouvrage démonte quantités de clichés éculés.
Vrai-faux
Françoise Héritier revient sur l'idée d'un partage des tâches "naturel" : l'homme à la chasse, la femme à la grotte avec les gosses. Elle dit que dans les sociétés où les hommes chassaient, la viande qu'ils ramenaient ne constituait que 20% de la nourriture du groupe, tandis que la cueillette des femmes en représentait 80%. Pourtant l'image de l'homme vaillant chasseur a toujours été valorisée. Jaloux du "privilège exorbitant d'enfanter" des femmes, le groupe des hommes s'est tacitement entendu pour marginaliser l'autre sexe. En écrivant l'Histoire, ils s'assuraient de transmettre l'idéologie patriarcale et un pouvoir sans partage.
Fétichisme
Michelle Perrot explique que les hommes ont toujours été obsédés par les cheveux de leurs compagnes. Une fixette qui leur a inspiré des théories sur le port du voile par exemple (et qui fait les beaux jours de multinationales qui soutiennent les femmes dans leur combat pour soigner leur chevelure). La femme dispose peu de son corps, véritable terrain de conquête. L'historienne analyse ainsi le viol ordinaire: «De tout temps, le danger, c’est le viol.» Elle explique qu’«il a régné un extraordinaire silence sur le viol. La jeune fille, qui n’a pas réussi à se défendre, est considérée comme coupable.» Les comportements actuels des femmes restent aujourd'hui encore conditionnés par cette transmission des peurs, des hontes. L'exercice de la domination masculine repose sur des rapports de force dont la partie très visible est la violence.
Sexe
Quant à la sexualité féminine, le point de vue masculin propose deux visions : la frigide et la pute. Sylviane Agacinski complète un tableau déjà bien noir en fustigeant la psychanalyse de Freud et de Lacan, fondée sur leur conviction étroite que le sexe, c'est le pénis. Disons que les femmes en ont vu des vertes et des pas mures depuis quelques millénaires et que la prochaine étape est de définitivement ringardiser les phallocrates de tout poil. Aux féministes et aux autres d'investir les terrains d'expression, de création et de pouvoir pour que l'histoire des femmes ne soit plus un genre mineur.
A vos stylos !
Françoise Héritier, Michelle Perrot, Sylviane Agacinski, Nicole Bacharan
La plus belle histoire des femmes
Ed. du Seuil, 2011, 308 pages.

La production d’enfants : une injonction ambivalente
Plutôt que d'ambivalence, on peut parler de méfiance chez les féministes radicales face à la question des enfants: d'abord parce qu'en faire constitue l’obstacle principal à l’égalité entre les sexes, ensuite parce que la maternité a été historiquement construite comme étant incompatible avec la participation à la sphère publique, renvoyant ainsi les femmes à leurs fourneaux. En outre, d'un point de vue essentialiste, la maternité est bien la preuve d’une différence biologique entre les femmes et les hommes et justifie ainsi leur condition spécifique complémentaire dans l’ordre hétérosexuel et symbolique.
Ce numéro de Nouvelles Questions Féministes s'intéresse au prix à payer pour les femmes, qu'elles aient ou non des enfants. C'est donc une analyse économique qui est ici menée et non pas une analyse de la maternité comme on l'entend d'ordinaire. Cette perspective permet de mettre en lumière la pression et le contrôle exercés par la société sur des femmes qui au final culpabilisent ou sont discriminées qu'elles travaillent ou qu'elles restent à la maison. Les injonctions contradictoires sont explorées dans tous les cas de figure et dans tous les coins du monde: produire des enfants engendre en effet des inégalités qui ne se limitent ni à la sphère privée ni au territoire national.
Il est intéressant de constater un début de remise en question de la maternité comme raison d'être et épanouissement ultime pour les femmes mais aussi comme charge qui incombe forcément aux plus faibles.
Nouvelles Questions Féministes Vol. 30, No1
La production d'enfants
Coordonné par Anne-Françoise Praz, Marianne Modak et Françoise Messant
Editions Antipodes 2011, 144 pages, ISBN 978-2-88901-052-3
 L’auteure Adrienne Rich ne donne plus d’interview mais a fait une exception pour l’émiliE. Une occasion pour elle de préciser certains points et de revenir sur des controverses qui ont secoué les mouvements féministes lors de la parution de son essai « La contrainte à l’hétérosexualité ».
L’auteure Adrienne Rich ne donne plus d’interview mais a fait une exception pour l’émiliE. Une occasion pour elle de préciser certains points et de revenir sur des controverses qui ont secoué les mouvements féministes lors de la parution de son essai « La contrainte à l’hétérosexualité ».
AR : Même si j’ai lu et j’ai été impressionnée par l’essai de Rubin, ce qui a en fait suscité l’écriture de « La contrainte à l’hétérosexualité » émanait d’une demande d’un journal universitaire féministe, « SIGNS » pour lequel je devais contribuer à l’occasion d’un numéro spécial sur la sexualité. SIGNS n’avait jamais rien publié sur l’expérience lesbienne et avait même plutôt publié un article méprisant à ce sujet, du coup je me suis sentie obligée de relever le gant comme il se doit.
Même si je reconnais que « La contrainte à l’hétérosexualité », est toujours très pertinent et utile tant auprès des femmes identifiées hétérosexuelles que des lesbiennes, il me paraît également un peu basic aujourd’hui, presque trente ans plus tard. Nous étions, aux Etats-Unis, au tout début des recherches universitaires sur les différents aspects du féminisme —Histoire des femmes, santé des femmes, science, littérature et art, produits par les femmes mais effacés ou enfouis. On a pu en récupérer, explorer et théoriser beaucoup durant cette période. En un certain sens, je partais de zéro – malgré mes nombreux entretiens avec d’autres femmes.
Ce que je ressentais particulièrement et ce que j’exprimais alors, était que l’homophobie était contraire au féminisme et constituait même un danger. La peur de l’expression sexuelle des femmes a été un moteur et une force de répression dans tellement de traditions, de religion et de sociétés. Cela n’avait aucun sens pour les féministes de suivre un tel chemin.
Pensez-vous qu’à l’heure où les lesbiennes sont discriminées par les femmes hétérosexuelles, le concept de « continuum lesbien» est toujours une réalité?
AR : Le concept de « continuum lesbien» a toujours été beaucoup critiqué ici (aux Etats-Unis, ndlr) et a été parfois ultra-simplifié. Je ne sais pas si, et à quel point, ses valeurs sont applicables. Ce qui est particulièrement évident— une fois encore, je parle du point de vue états-unien, à vous de faire la part des choses pour ce qui est de l’Europe— c’est que l’élan d’activisme politique d’extrême droite ultra et fasciste qui s’est développé depuis l’élection de Ronald Reagan en 1980, inclut un regain d’homophobie, de violence contre les gays et les lesbiennes, de discrimination comme dans le règlement militaire du « Don’t ask, don’t tell »- mais aussi une augmentation des crimes racistes contre les personnes de couleur, les immigrants et récemment les gens identifiés comme musulmans. Il faut du courage pour être ouvertement gay, par exemple en tant que personnage public, enseignant-e ou élu-e.
Je ne pense donc pas que c’est juste une question de discrimination de la part des femmes hétérosexuelles- ça semble une vision trop étroite d’un contexte beaucoup plus large. Parce que la résurgence de l’extrême-droite est partout, pas juste aux Etats-Unis.
Diriez-vous qu’il existe une contradiction entre la posture wittigienne (les lesbiennes ne sont pas des femmes) et la vôtre (le continuum lesbien) ?
AR : J’admirais et j’appréciais beaucoup Monique Wittig, mais je pense que nous abordions les choses différemment, aussi bien du point de vue de la méthode que des références philosophiques et politiques. Je suppose que son concept s’appuie sur celui de Simone de Beauvoir, le fameux « on ne naît pas femme, on le devient. » Ce qui en soi doit être compris à la lumière de la phénoménologie et de l’existentialisme en France ( qui m’a beaucoup apporté, soit dit en passant.)
Comme je l’ai dit, le « continuum lesbien» était le meilleur moyen de suggérer la variété et la fluidité des relations des femmes entre elles—ce n’était pas un diktat. L’appeler continuum « lesbien » était une sorte de défi je pense.
D’un point de vue de l’égalité et des droits pour les femmes, pensez-vous que ces dernières ont renoncé à leur propre identité en tant qu’individu ? Ont-elles en fin de compte perdu le combat ? Sont-elles juste contentes avec ce (peu) qu’elles ont acquis grâce aux luttes féministes ?
AR : Cette question me semble un peu trop générale —quelles femmes ? De quelle classe, race, origine, zone géographique dans les systèmes global et local ? Qui est derrière ce « les ? » Une des faiblesses du mouvement des femmes aux Etats-Unis en perte de vitesse dans les années 80 a été l’incapacité de continuer à poser cette question: Qui envisageons-nous lorsque nous pensons « femmes » ? Que pensons-nous lorsque nous disons « nous » ? J’ai écrit « The Politics of Location » justement pour aborder ces questions, ou tout du moins pour dire : Il y a des problèmes à ce niveau.
A la fin des années 60, un postulat féministe disait : « Aucune femme ne sera libérée tant que nous ne le serons pas toutes ». Qu’en est-il aujourd’hui d’après vous?
AR : La situation actuelle est très difficile en ce qui concerne la liberté en général, exceptée la liberté du capitalisme d’aller là où il veut et de prendre ce qu’il veut. Un exemple serait la délocalisation— d’emplois là où le travail est moins cher et non syndiqué, laissant les travailleur-e-s d’ici sans rien. Les femmes avec enfants sont particulièrement touchées. Quant aux femmes qui acceptent cet état de fait comme légitime et qui en bénéficient, elles contribuent à la privation de liberté de tous, femmes et hommes.
Pourquoi êtes-vous hostile au «développement personnel »?
AR : Si par «développement personnel » on entend l’apologie de l’auto-réalisation et de la personnalisation en général— c’est comme aller dans le sens des publicités des produits de beauté qui vous promettent si vous les achetez que vous serez plus heureux, mieux et plus épanoui-e-s. Ou c’est vous retrouver dans une pièce avec des femmes qui vous ressemblent et vous parlez de vos problèmes dans le vide. Ça n’a rien de libérateur. Aux Etats-Unis, c’est une tradition historique de valoriser la « réussite » personnelle. Si vous subissez un « échec » c’est votre échec personnel et la société peut vous rayer de la liste. C’est devenu l’axe de politique intérieure de notre gouvernement.
Quel regard portez-vous sur les luttes et sacrifices passés ? Sur celles et ceux à venir ? Etes-vous toujours engagée dans ces mouvements ?
AR : Au début des années 80, j’ai commencé à repenser ma relation à ces mouvements de femmes et aux groupes auxquels j’appartenais. Je suis allée au Nicaragua durant la période sandiniste, la révolution socialiste que la CIA redoutait tant, et qu’elle a tout fait pour décrédibiliser. J’ai vu comment la pauvreté touchant à la fois les femmes et les hommes était la conséquence de l’accaparation des richesses et des ressources par une petite classe possédante soutenue par le gouvernement états-unien. J’ai aussi étudié la révolution cubaine, bien que n’étant jamais allée à Cuba. Et pour la première fois, j’ai sérieusement lu Marx, avec les lettres et les articles de la révolutionnaire socialiste Rosa Luxemburg et du marxiste humaniste Raya Dunayevskaya. Tout ceci disait le besoin d’ouvrir les fenêtres pour avoir un souffle d’air frais. En tant qu’ Américaine élevée dans les années 40 et 50, durant la période mccarthiste et la Guerre froide, j’ai été exposée à un anti-communisme et un anti-socialisme virulents, à une promotion de l’Amérique particulièrement anhistorique qui agissait comme une propagande pour la domination américaine sur le monde— et sur l’Europe de l’Ouest. Les Etats-Unis ont montré leur vrai visage au monde lors des bombardements sur Hiroshima et Nagasaki et étaient résolus à écraser les sympathisants gauchistes et socialistes américains. En outre, avec cet anti-communisme s’est développée une homophobie sans pitié.
C’est ainsi que ma relation au féminisme et aux thématiques gaies et lesbiennes s’est conjuguée et développée avec une perspective sur l’histoire, sur les problématiques de classe et le sens de l’impérialisme. Je suis venue au féminisme avec une forte identification au mouvement des droits civiques et à l’opposition à la guerre du Vietnam, aussi en tant que guerre raciste. Tous ces éléments ont fini par s’assembler.
Et, dans le mouvement tel que je l’ai connu, ce sont les femmes de couleur, les féministes de la classe ouvrière blanche et les lesbiennes qui, par leur expérience et leur voix, ont eu un profond effet sur moi — notamment, Audre Lorde, June Jordan, Irena Klepfisz, Barbara Smith, Toni Cade Bambara, Angela Davis, Melanie Kaye-Kantrowitz— toutes écrivaines, enseignantes et militantes, des femmes extrêmement créatives et brillantes que j’ai eu le privilège de connaître et avec qui j’ai travaillé de différentes manières.
Qu’est-ce que ça vous fait d’être considérée comme une icône parmi certaines jeunes lesbiennes ?
AR : Je déplore l’icônisation, la célébrité et l’objectification quelles qu’elles soient. Si mes paroles sont utiles — et j’écris en l’espérant— c’est différent. Un-e écrivain-e, comme un-e enseignant-e, ne sait pas où ses mots vont aller. Un-e étudiant-e peut aller en cours apparemment sans être intérésse-é ni touché-e et des années plus tard vous découvrez que quelque chose que vous avez dit ou un livre que vous avez fait étudier, a semé quelque chose en elle/lui et l’a aidé-e à se développer. J’espère que les jeunes— et pas seulement les jeunes lesbiennes— trouveront un écho à mon travail pour découvrir en eux ou avec d’autres la force d’aborder des problématiques difficiles, de reconnaître et de dénoncer la censure et le mensonge, d’agir de manière responsable et courageuse là où c’est nécessaire, de résister au confort du suivisme, de se méfier des tendances séparatistes et étroites d’esprit qui peuvent dessécher l’âme et qui, au final, isolent et affaiblissent.
Propose recueillis par Nathalie Brochard
En collaboration avec Leo Williams
©l’émiliE
• Lire la Critique de « La contrainte à l’hétérosexualité »
Le dernier roman de l’écrivaine turque Elif Shafak crée des correspondances entre deux époques et deux cultures. Une Américaine d’aujourd’hui découvre un courant mystique de l’islam du XIIIe siècle, le soufisme. Cette rencontre va transformer sa vie.
Ella Rubinstein, mère de famille et épouse, vit confortablement à Northampton, Massachusetts. A la veille de ses 40 ans, Ella décroche un travail de lectrice pour une agence littéraire de Boston. C’est ainsi qu’elle découvre Doux blasphème, d’Aziz Z. Zahara. Ce récit retrace la rencontre entre un derviche errant, Shams de Tabriz, et un érudit musulman, Rûmi, en Anatolie au milieu du XIIIe siècle.
Ella, cette «femme aux manières discrètes, au cœur généreux et à la patience d’une sainte» lit cet ouvrage comme s’il lui était personnellement destiné. Ce livre et la correspondance qu’elle entame avec son auteur vont changer sa vie. «Soufi mon amour», voyage hors du choc des civilisations, est aussi un roman placé sous le signe des rencontres qui transforment les vies. Satisfaite, voire comblée par sa vie ces vingt dernières années, Ella Rubinstein «ressentait un épuisement qu’elle n’avait jamais connu auparavant». Ses enfants ont moins besoin d’elle, son couple s’est perdu en cours de route et, à 40 ans, elle ne sait comment poursuivre son existence. Peut-être le moment idéal pour découvrir le soufisme et rencontrer Aziz, Européen devenu soufi.
Pourtant, qu’il y-a-t-il de commun entre une juive américaine du XXIe siècle et un poète mystique perse du XIIIe? En écoutant les nouvelles du jour, on ne peut que souscrire à cette introduction de Doux blasphème : «De bien des manières, le XXe siècle n’est pas si différent du XIIIe siècle. Tous deux figureront dans l’Histoire comme des périodes d’affrontements religieux, d’incompréhensions culturelles, où le sentiment général d’insécurité et la peur de l’Autre furent sans précédent. A de telles époques, le besoin d’amour est plus fort que jamais.»
Le dispositif du dernier roman d’Elif Shafak avec ses trois récits qui se font écho - la vie de famille d’Ella, sa lecture de Doux blasphème et son échange de mails avec son auteur - crée des correspondances au-delà des époques et des cultures. «Est-ce que relier les terres lointaines et les cultures étrangères n’est pas une des forces de la bonne littérature?» Elif Shafak y parvient. Et l’on ne peut que se réjouir du succès de Soufi, mon amour tant en Orient qu’en Occident.
Estelle Pralong
Liens:
]]>